
VICENÇ BATALLA. Thierry Frémaux est quelqu’un d’atypique dans le monde du cinéma. Détenteur de l’agenda la plus complète de ce circuit, comme directeur de l’Institut Lumière à Lyon et délégué général du Festival de Cannes, ses habitudes n’ont pas tant changé depuis une trentaine d’années. Il continue à se déplacer à vélo à Lyon, à Paris et dans sa ville de naissance à Tullins, l’Isère, en 1960. À ses soixante ans, il s’est replongé sur ses premiers trente ans dans lesquels il est devenu ceinture noire (4ème dan) et professeur de judo, en parallèle à ses recherches sur l’histoire du cinéma. Mais dès son engagement comme salarié à l’Institut Lumière, présidé par Bertrand Tavernier, il avait laissé la pratique de cet art martial.
Avec Judoka (Stock, 2021), son deuxième livre après Sélection officielle (Grasset, 2017), il revient sur sa jeunesse et son apprentissage de la vie qui le mène à raconter l’histoire de cet sport en parallèle à celle du cinéma et la personnalité qui s’est forgé pour affronter le monde des salles obscures, avec son imaginaire, sa magie, son glamour et aussi ses vanités. Se rappeler de ses combats et ses cours dans des salles de la banlieue lyonnaise, l’amène à faire un travail d’introspection qui contraste avec le côté plus lumineux de son métier.
Pour cette raison, c’était une chance de pouvoir faire l’interview début avril dans son bureau de l’Institut quand la pandémie de Covid continuait de bloquer les déplacements et maintenait fermés les cinémas en France. Et juste quelques jours après la mort du président Tavernier, le 25 mars, à qui on avait eu aussi l’occasion d’interviewer au Festival Lumière en 2019. Logiquement, la conversation a débuté autour de cette figure tutélaire à qui on revient pendant tout l’entretien.
Un entretien qui finit avec un ajout de dernière heure sur l’annonce de la réouverture des cinémas après six mois et demi et les propos de Frémaux sur la prochaine édition du Festival de Cannes exceptionnellement entre le 6 et 17 juillet, “premier événement mondial post-pandémie”. Dans un bureau de la Villa Lumière plein de livres et d’affiches cinéphiles, Frémaux montre sa capacité de traiter de tous les sujets et son habilité de bien esquiver les plus épineux à l’intérieur et à l’extérieur de l’interview comme si sur un tatami on se trouvait.
Quel est le vide qu’a laissé la disparition de Bertrand Tavernier à l’Institut Lumière ? Comment est-ce que vous le vivez ?
“Personnellement, j’éprouve un vide affectif, mais aussi un manque cinéphile. A l’Institut Lumière, Bertrand n’était pas dans la direction quotidienne mais sa présence à nos côtés était permanente. Il appelait, il avait des idées de programmation, d’hommages. Mais il a laissé tellement de traces qu’il y aura de quoi s’inspirer. C’est presque une motivation supplémentaire. La vie doit continuer, hélas”.
Vous vous attendiez à cette disparition ? Parce qu’il avait été malade, on le savait. Il n’a pas pu venir au Festival Lumière en octobre dernier, mais vous avez pu lire son discours adressé aux frères Dardenne…
“Il avait des problèmes de santé, il ne s’en cachait pas. Mais nous n’imaginions pas que cela irait si vite…”.
Dans la lettre que vous avez envoyée aux abonnés de l’Institut Lumière, vous racontez qu’il écoutait la musique de son film Autour de minuit (1986), de Herbie Hancock, dans ces derniers jours…
“Quinze jours, trois semaines plus tôt, il voyait des films, il écrivait ses mémoires. Et il écoutait beaucoup de musique, beaucoup de jazz. A son retour de l’hôpital, il est revenu dans la maison, à Sainte-Maxime. Il est mort chez lui, auprès de son épouse”.
On va pouvoir les lire ses mémoires? Les a-t-il pu terminer ?
“Oui, on pourra les lire. Ce qui est écrit est écrit. Et c’est magnifique !”.
Et il avait le projet d’élargir l’histoire des cinquante ans de cinéma américain aux cent ans…
“Oui, c’est un immense projet que je lui ai proposé il y a quelques années. Ça s’appellera ‘100 ans de cinéma américain’. Son co-auteur, Jean-Pierre Coursodon (1935-2020), avait corrigé ses textes et Bertrand les siens, même s’il ne s’arrêtait jamais ! Il nous faut maintenant l’éditer, le fabriquer, le publier”.
Les réactions à la mort de Bertrand Tavernier

On sait qu’il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui se sont ému·e·s par sa disparition…
“Énormément…”.
Martin Scorsese, mais pas que lui…
“Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Nanni Moretti… Cristian Mungiu, qui fut son assistant sur ‘Capitaine Conan’ (1996)… Sa disparition a laissé quelque chose de très fort qui prouve son importance comme cinéaste et comme être humain. Les télévisions françaises ont beaucoup programmé ses films. Qui ont été de grands succès d’audience et un grand succès critique. Les gens ont adoré revoir les films ! ‘Coup de torchon’ (1981) est premier sur Netflix en France. L’émotion a été gigantesque, comme pour Jean-Pierre Bacri dont on s’est aperçu à quel point il était populaire. Bertrand aussi était très aimé”.
Même si une partie de la critique n’appréciait pas ses films…
“Oui, une famille critique particulière, celle issue des ‘Cahiers du cinéma’…”.
Dans quelques articles sur sa mort on disait qu’il était contre les chapelles dans le cinéma, mais on rappelait que cette position n’est pas possible quand on juge nécessaire de trancher…
“Il était contre les chapelles, mais certaines chapelles étaient contre lui…”.
Vous avez été choqué par l’article de ‘Libération’ ?
“Non, ça ne m’a pas choqué. Je m’y attendais”.
Parce que vous les connaissez…
“Libération’ ne serait pas ‘Libération’ s’ils avaient dit : “ah, pauvre Bertrand Tavernier qui vient de mourir !”. Mais j’aurais préféré les voir écrire sur son cinéma quand ses films sont arrivés sur Netflix il y a quelques mois, pas au moment de sa mort parce qu’elle faisait l’actualité. Ils avaient largement le temps de dire à quel point ils le détestaient. Le faire au moment de sa mort, en mettant sa photo à la Une du journal, beaucoup de lecteurs ont trouvé ça discutable”.
C’est un peu le caractère tranchant qui a souvent la France.
“Et spécialement sa critique cinéma”.
N’est-ce pas une caractéristique aussi des spectateurs ?
“Bertrand considérait normal d’être jugé, normal de ne pas être aimé de tous. Mais vous savez, la surprise n’est pas venue de ‘Libération’ ou du ‘Monde’ qui a parlé d’un ‘artisan’ et on sait que le mot artisan, dans leur bouche, c’est péjoratif. La vraie surprise, c’est à quel point son cinéma et sa personnalité étaient très aimés et combien les gens ont voulu le dire. Qu’on le laisse en paix maintenant. Et le temps jugera”.
La formation d’un caractère racontée à Judoka

Si on parle de Judoka, Bertrand Tavernier lui, il y apparaît plusieurs fois. C’est lui qui vous a proposé de passer du bénévolat à vous professionnaliser à l’Institut Lumière.
“Justement, je viens du sport. Je viens du judo, des clubs. Je viens aussi, je l’explique, d’une famille qui avait des engagements politiques. Mon enfance, c’était le sport, le monde adulte sera le cinéma. A l’époque, je suis universitaire mais je sais que le cinéma sera l’affaire de ma vie. J’aime la cinéphilie, aussi. Comme apprenti historien, je travaille sur la revue ‘Positif’, qui est née à Lyon. Bernard Chardère, le fondateur de ‘Positif’ en 1952, est le premier directeur de l’Institut Lumière, Bertrand Tavernier le premier président. Il est déjà une grande figure, un cinéaste que j’admire. Je l’admirais avant de travailler avec lui. Pour moi, ‘Coup de torchon’ ou ‘L’Horloger de Saint-Paul’ (1974) étaient de grands films. Hors la Nouvelle Vague et ses enfants, il était l’un des grands cinéastes français, avec Blier, Corneau, Sautet et quelques autres. Avec Bernard Chardère, il devient un deuxième point d’appui. Je me suis dit : je veux travailler, bénévolement comme dans le sport, à l’Institut Lumière. Quelques années après, je deviens directeur parce que Bernard Chardère et Bertrand Tavernier me font confiance”.
En fait, l’écriture de Judoka est la reconnaissance de ce qui vous a formé comme personne jusqu’à les trente ans, et que vous avez laissé de côté pendant ces derniers trente ans. Une formation du caractère pour travailler dans un milieu comme le cinéma, qui n’est pas non plus facile.
“Oui, c’est exactement cela. Aujourd’hui je ne parle que de cinéma tout le temps. Et, avant, je ne parlais que de judo. Et je me suis rendu compte en écrivant qu’il est toujours là… J’ai voulu me souvenir que j’avais un autre mentor qui était mon professeur de judo, Raymond Redon, à qui le livre est dédié. Je me suis dit que tout ça était lié. À la fin du livre, j’explique que d’avoir pratiqué un sport méconnu m’a peut-être formé à devenir cinéphile, aux obscurités de l’histoire du cinéma. À avoir l’habitude de m’intéresser à Jigoro Kano (l’inventeur du judo). Personne ne sait qui il est. Donc, je m’intéresse aussi à André de Toth (réalisateur hongrois-américain), très inconnu aussi ! Et, quelque part, ce goût de la minorité m’a été donné par le judo et ça m’a servi comme arme dans mon travail. C’est-à-dire, savoir qu’il faut se battre pour ce à quoi on croit et ne pas suivre les troupeaux. Je l’ai vécu dans le judo, je l’ai vécu ensuite dans le cinéma. Et dans toute une série d’attitudes humaines, de relations, mais surtout de dénouements sociaux. Comme vous, journaliste, il est sept heures du soir, mais nous sommes là tous les deux, on travaille parce qu’on croit à ce qu’on fait. Pas parce qu’on est payé… Ça, je l’ai appris au judo.”
Vous a-t-on offert de rentrer en politique ?
“Oui. J’admire ceux qui s’engagent politiquement. Mais je fais autrement. Pour paraphraser Godard qui disait : “il ne faut pas faire du cinéma politique, il faut faire politiquement du cinéma”, je me disais : “il ne faut pas mener une vie politique, il faut politiquement mener sa vie”. Je m’aperçois à quel point tout cela était lié. Nous sommes une génération de cadets. L’érudition nécessaire en judo est la même érudition en cinéphilie. Se souvenir, se dire : “enfant, j’ai quelque chose, je connais le judo ; adulte, j’ai autre chose, je connais le cinéma”. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas dans la vie, mais je connais le judo et je connais le cinéma. Et j’ai voulu me souvenir du jeune homme que j’étais quand j’étais judoka, ce que ça m’a apporté. Me souvenir que je voulais rester professeur de judo. Être universitaire, écrire des livres et faire du judo. Ça m’allait très bien”.
La littérature vous attirait déjà…
“La littérature et l’histoire m’attiraient. J’étais un “apprenti historien”, me disait mon professeur de thèse. Je ne voulais pas quitter Lyon. Quand je suis arrivé à l’Institut Lumière, je n’en suis plus parti. Gilles Jacob (ancien président du festival du film), l’a compris quand il m’a proposé Cannes: “D’accord, je comprends que vous voulez garder un pied à Lyon”. Parce que mes aînés Freddy Buache, en Suisse (fondateur de la Cinémathèque Suisse), Fred Junck, à Luxembourg (fondateur de la Cinémathèque Luxembourgeoise), Raymond Borde (fondateur de la Cinémathèque de Toulouse), Bernard Chardère… ces gens-là restaient chez eux. Sans doute le judo vous apprend-il la modestie. Je suis le délégué général du Festival de Cannes, le plus grand festival du monde. C’est une chance et un privilège fantastique, mais je n’en ai jamais eu l’ambition. J’ai fait ce que j’avais à faire. Je me suis accompli là où je devais m’accomplir. Et je continue, mais aussi peut-être parce qu’à un moment, et c’est cela que j’ai appris par le judo, j’ai compris que ma mission était de me dévouer aux cinéastes, en étant un animateur culturel. À avoir plaisir à défendre leurs films, à avoir plaisir à les accueillir. Les rendre heureux. C’était la même chose qu’enseigner le judo, prendre un enfant et l’amener jusqu’à la ceinture noire. C’est-à-dire : on est là pour les autres”.
Cela veut dire que de la même manière que vous auriez pu devenir un professionnel du judo, vous auriez pu devenir un cinéaste, en faisant des films, mais vous avez préféré travailler dans le collectif.
“Absolument. C’est peut-être pour cela que j’écris des livres maintenant parce que je me dis qu’il faut, au moins, que je fasse quelque chose de personnel ! Ou des documentaires sur les Lumière (l’écriture et la narration de Lumière ! L’aventure commence, 2017). Je sais qu’il faut aussi s’accomplir pour ne pas avoir de regrets… Tout cinéphile veut s’essayer à faire des films. Mais j’arrive rue du Premier Film, ici, et il fallait tout faire. J’étais plus utile là à construire l’Institut Lumière, à réussir la succession de Gilles Jacob, que d’ajouter un film à l’histoire du cinéma. Un film de plus ? Avec du talent, sans talent ? Il ne fallait pas. Si c’est une sorte de sagesse, elle vient du judo”.
Cela vous a permis d’affronter le public, d’un côté, et d’affronter les tensions qu’il y a toujours derrière le circuit du cinéma…
“Oui, c’est pour cela que j’ai voulu parler aussi de la défaite. La défaite n’est pas grave, si on apprend”.
La chute…
“La chute, et après la défaite. La victoire n’est pas belle si on n’en retire rien. Souvent, on apprend plus d’une défaite que d’une victoire. L’année qu’on vient de passer, tous sur cette planète, ça nous a beaucoup servi, non ? Il faut que cela nous serve à quelque chose”.
Les Lumière et Jigoro Kano
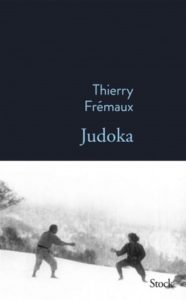
Vous auriez pu écrire le livre sans la pandémie ?
“Oui, c’était prévu. Je devais même le finir avant la pandémie, je l’ai fini pendant. Mais j’étais en retard évidemment (sourire)…”.
Conclusion ?
A l’arrivée, tout mène à la sagesse. J’ai soixante ans. Bertrand Tavernier, à part ses films, a toujours été dévoué aux cinéastes. Et moi aussi, à lui et à tous les cinéastes. J’espère qu’il y a des jeunes générations capables d’admirer. Notre devise venait de Victor Hugo : “J’admire comme un brute !”. Bertrand m’a fait réfléchir là-dessous. Il m’a influencé, pour le cinéma. Avec ce livre, je voulais dire que, dans la vie, j’ai d’abord appris à admirer par le sport : Muhammad Ali ou Eddy Merckx”.
Je me rappelle bien de la première édition du festival Sport, littérature et cinéma, ici à l’Institut Lumière, avec la présence emblématique d’Eddy Merckx.
“Admirer Eddy Merckx, admirer Giacomo Agostini, admirer Jean-Claude Killy, pour moi c’est la même chose qu’admirer Eisenstein, ou Martin Scorsese. C’est la capacité à admirer, à admirer la beauté, le talent… Mais il faut aussi m’accomplir. Moi, je m’accomplissait en étant devenu un professeur de judo, en formant des enfants. Et je m’accomplis ici, et je m’accomplis moins depuis un an parce qu’on ne peut pas travailler correctement, mais je m’accomplis ici ou à Cannes en étant dévoué aux autres”.
Il y a une autre chose que les gens ne savent pas, surtout s’ils ne sont pas de Lyon, c’est que vous avez grandi dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Un projet progressiste de cité avec ses grandes tours dans les années soixante, qui est devenu aux années quatre-vingt un endroit des maux sociaux. Ça vous a donné une image beaucoup plus ouverte du monde ?
“Bien sûr. Parce que je suis originaire d’une famille de paysans, parce que mes parents étaient très engagés politiquement, parce qu’on habitait dans une cité, dans une ZUP (Zone à urbaniser en priorité), parce qu’en même temps dans le judo il y avait un brassage social comme dans le cinéma… Moi, j’ai grandi avec les ‘Cahiers du cinéma’, pas avec ‘Positif’. Et, un jour, j’ai appris qu’il y avait ‘Positif’. J’ai pris les deux, et je tombe sur Bertrand qui dit : “mais moi, j’adorais dire du bien de Delmer Daves dans les ‘Cahiers’ et de Samuel Fuller dans ‘Positif”. Être de gauche avec des gens de droite, et de droite avec des gens de gauche. Vive la démocratie ! Aujourd’hui, je peux dire des choses très fidèles à la classe populaire dans laquelle j’ai grandi, et très infidèles à ceux qui parlent pour la classe populaire sans la connaître : la gauche des années quatre-vingt, quatre-vingt-dix… Pas toute la gauche. Là-dessous, avec Bertrand on s’est bien trouvés. Il était de gauche, mais il a été un des premiers à protester contre les accords avec Berlusconi, contre la fausse modernité dont la gauche française se faisait défenseur. Et il s’est fait critiquer par les gens de gauche, mais lui il disait : “je reconnais le réalisme du Gouvernement, mais vous ne m’empêcherez pas de parler, même si je suis de votre famille politique”. Cette honnêteté-là c’est important. Comme dans 50 ans ou 100 ans de cinéma américain, quand il dit : “je me suis trompé sur tel ou tel cinéaste, j’ai revu ses films, j’ai changé d’avis”. Se disputer, se réconcilier, débattre, changer d’avis, n’est-ce pas la meilleure des trajectoires ?”.
Parfois, c’est une question d’orgueil…
“L’orgueil empêche beaucoup de choses, et la sagesse permet beaucoup de choses. Ou peut-être est-ce le contraire !”.
Une autre chose que vous remarquez dans le livre est que le judo et le cinéma sont nés dans la même époque. Il y a, là-bas, un parallélisme auquel on n’y avait pas pensé. C’est une bonne façon de raconter l’histoire de deux en même temps.
“Je m’intéressais déjà à Jigoro Kano, et je savais déjà qu’il y avait un livre à faire sur le judo. Mon éditeur me rappelait qu’il fallait qu’il soit très personnel. Et je lui répondais : “oui, mais je veux parler de Jigoro Kano !” C’est pour cela qu’il y a cette architecture qui alterne les chapitres historiques et les passages plus personnels. En arrivant ici, André de Toth avait dit que l’Institut Lumière, c’est La Mecque, c’est Bethléem. Moi, je pensais : c’est le Kodokan ! Là où est né le judo (où Kano a ouvert sa première salle à Tokyo, en 1882). En l’adoptant comme personnage principal, je prenais aussi le risque que la noble figure de l’inventeur ne soit pas aussi parfaite dans la réalité”.
Jigoro Kano meurt en 1938, dans un moment un peu compliqué…
“Il aurait pu se révéler être un belliciste de premier ordre. En fait, celui qui invente le judo est un homme qui se comporte toujours bien. Il faisait partie de ceux qui, à la fin du dix-neuvième, pensaient que l’avenir serait formidable… L’avenir n’a pas été formidable. Le vingtième siècle a été horrible. Le cinéma faisait aussi partie de cette utopie et ce parallélisme est assez beau, pas seulement du judo mais de l’histoire du sport. Pas seulement du cinéma, et du cinématographe, de l’histoire d’un monde qui va vers un futur qui n’était pas celui de la dureté, des usines du dix-neuvième siècle, de l’Ancien Régime… Après, ça n’a pas été le cas. C’est pour cela que je m’intéresse toujours beaucoup, à cause de la pandémie, à tous les débats sur le monde d’après”.
Et, en fait, il n’y a pas beaucoup de films sur le judo.
“Il y a beaucoup de grands documentaires sur le sport, mais il n’y a pas de grands films sur le sport. Les Américains en ont fait beaucoup. Mais il n’y a pas de grands films sur le football. Il y a ‘Raging bull’ (Martin Scorsese), pour la boxe. Il y a ‘Any given Sunday’ (‘L’enfer du dimanche’, Oliver Stone), pour le football américain. ‘Blue chips’, de William Friedkin, sur le basket. Il y a des choses. Pour le football, il y a ‘Coup de tête’, de Jean-Jacques Annaud. Mais c’est difficile. Vous savez pourquoi ? Parce que la télévision a filmé le sport. Donc, le réflexe d’images que nous avons est la télévision. Sauf la boxe, parce que là il y a eu la photographie, et la littérature. Pas dans le football, le vélo… Mais les quelques films sur le judo sont formidables. Surtout le film de Kurosawa. C’est génial que le premier film d’un des plus grands cinéastes de l’histoire soit sur le judo (‘La Légende du grand judo’, 1943). Peu de gens le savaient, j’ai fait un chapitre là-dessous”.
Un nouveau journal sur la pandémie

Sur votre premier livre, Sélection officielle, que j’ai lu par séquences parce c’est un journal, on a dit qu’il y avait peut-être trop de name-dropping. Je le trouve plutôt un livre d’un admirateur des gens que vous croisez dans le Festival de Cannes ou le Festival Lumière, à Lyon.
“Non, c’est très simple. À la fin de ‘Sélection officielle’, j’ai prononcé moi-même l’expression ‘name-dropping’, qui n’est pas une expression très connue. Mais parce que je l’ai dit, ils ont répété : “il y a un peu beaucoup de ‘name-dropping” (sourire). C’était une plaisanterie. Mais, dans la vie je parle à des gens qui sont des gens connus. C’est mon métier. Il n’y a pas à s’en étonner. Je suis en train d’écrire un nouveau journal : le journal du Festival de Cannes qui n’a pas eu lieu l’an dernier, et dont on a longtemps ignoré s’il aura lieu en 2021. On sera loin du ‘name-dropping”.
Mais vous pouvez reconnaître qu’à Judoka vous vous investissez plus.
“Peut-être parce que c’est lié à l’enfance”.
Vous allez plus loin, vous rentrez beaucoup plus dans votre intérieur, dans votre vécu… Et, du coup, c’est plus atemporelle.
“Mon histoire dans le judo m’appartient, alors que Cannes c’est collectif… Quand je parle de Cannes, je parle de notre communauté, de moi à l’intérieur de la communauté. ‘Judoka’ est plus personnel”.
Et, quand vous avez fini l’écriture, vous vous êtes vu différent ?
“C’est bizarre, parce que c’est un livre qui est très aimé, qui ne suscite pas de critique négative ou de commentaire malveillant. C’est une sorte d’autobiographie de jeunesse. Je me suis juste rappelé du futur adulte que j’allais devenir. Mais le plus beau compliment qu’on m’a fait est que beaucoup des judokas, célèbres et anonymes, m’on dit : “c’est toi, mais c’est moi ; ta jeunesse est ma jeunesse ; ce que tu racontes, je l’ai vécu ; j’ai vécu la chute, j’ai vécu l’apprentissage ; j’ai vécu la peur de la défaite ; j’ai vécu l’ivresse de la victoire ; je suis devenu professeur ; je me suis intéressé aux champions ; j’étais judoka, et tout le monde se fichait de moi ; j’étais ceinture noire”. Tout le monde m’a dit : “ce que tu décris, on l’a vécu”. Je suis très fier de ça”.
Peut-être avez-vous avez été plus sincère que jamais…
“Et parce que, par ailleurs, c’est une vie qui n’a pas été racontée par personne. Elle a été beaucoup vécue, mais pas racontée. La mienne, et celles de tous les autres… J’ai parlé de mon époque, et de moi comme garçon. Un autre judo devra être raconté par les filles. Aujourd’hui, le judo, en France, est très fort chez les féminines. Et spécialement, des athlètes qui viennent de la banlieue, comme moi”.
On parle beaucoup de la boxe féminine en France, pas autant au judo…
“C’est à elles de le raconter”.
Rendez-vous au Festival de Cannes

Vous me parliez du monde de l’après-pandémie. Comment imaginez-vous votre métier ?
“Mon métier, ou nos métiers, même vous, journalistes, vont évoluer. Évidemment, la révolution internet continue à tout changer. Y compris l’arrivée des plateformes, bien sûr. Le succès des plateformes, le triomphe des plateformes même, au moment où les salles sont fermées, c’est une constatation terrible qui doit nous obliger à réagir”.
Par rapport à Cannes, et avec les nouvelles annonces du Gouvernement, est-ce la voie est dégagée pour tenir finalement le festival du 6 au 17 juillet ?
“Oui, Cannes aura lieu. Nous avions dit qu’il n’y aurait pas une deuxième année sans le festival. Nous avons refusé de faire un festival ‘online’ qui est une absurdité, puisque c’est exactement l’inverse de ce qu’est un festival. Nous voulions attendre le meilleur moment et il est en train d’arriver. Il faut bien sûr tenir compte d’une prudence nécessaire à observer face à une épidémie qui est loin d’être anéantie, mais c’est une formidable nouvelle pour nous, comme pour nos collègues des salles de cinéma, des musées, des théâtres, etc… Nous pourrons nous déplacer plus loin, retourner au restaurant, au stade et bientôt dans les salles de concerts. Mais pas quitter les masques, pas cesser de se distancier, pas se détourner du vaccin quand ce sera notre tour.
En juillet, nous ferons un Cannes à 100 % de jauge, autre information inimaginable il y a peu ! Et avec les restaurants et terrasses de pleine bourre. Et sans couvre-feu ! Nous sommes heureux de cette issue, plus encore des merveilleux messages qui nous parviennent et nous félicitent “d’avoir tenu bon”… Nous n’avons pas tenu bon, nous avons juste fait ce que nous avions à faire, dans la force de nos convictions et de nos désirs, qui sont aussi ceux des festivaliers. Nous n’avons juste jamais cédé à l’impatience, à l’irresponsabilité ni au découragement. Ça n’était pas difficile : c’est un tel privilège d’être là où nous sommes, au service du cinéma mondial. Nous allons donc tous nous rejoindre dans le sud de la France pour le premier événement mondial post-pandémie. Ce sera le festival des retrouvailles”.
Et en sachant que les salles rouvriront en France petit à petit à partir du 19 mai après six mois et demie fermées, vous pensez que les spectateurs auront l’envie de retourner au cinéma sur grand écran ?
“Ça ne fait aucun doute. Il y a un an, en France, entre les mois de juillet et octobre, les gens ont prouvé qu’ils revenaient”.
Mais on aura passé une demie-année sans salles de cinéma. Au printemps dernier, la fermeture avait été de trois mois. Et, entre-temps, les gens ont continué à s’abonner aux plateformes parce qu’on ne pouvait voir de nouveaux films autrement. Est-ce qu’il n’y a pas, ici à l’Institut Lumière, la peur d’un changement d’habitudes ?
“Le cinéma s’est toujours affronté à beaucoup de choses. La différence est que quand il s’est affronté à la télévision dans les années cinquante, à la vidéo aux années quatre-vingt, à internet il y a quinze ans, les salles étaient ouvertes. Il pouvait se défendre. Là, les salles sont restées fermées et font face à une concurrence brillante, moderne, créative. Donc, ce sera aux salles, à nous tous, d’inventer une attractivité nouvelle…”.
Views: 403
