
VICENÇ BATALLA. Il y a une histoire et une mémoire dans le Roussillon et toute l’actuelle région d’Occitanie qui hantent les esprits, soit pour ceux qui l’ont vécu et sont toujours vivants, ou pour leurs descendants. Celles de la Retirada d’un demi million des républicains catalans et espagnols en 1939 et les camps de concentration où eux se sont retrouvés. Le film d’animation Josep, de Aurel, continue ce travail de mémoire mais d’une manière assez originale parce que son personnage central est le peintre et illustrateur Josep Bartolí (Barcelona, 1910-New York, 1995), dont on n’arrête de révéler des surprises. Le dessinateur politique Aurel (Le Monde, Politis, Le Canard enchaîné… ) en extrait un portrait réaliste et impressionniste, à l’instar des caricatures et croquis que Bartolí avait lui-même réalisés pendant son passage par tous ces camps d’internement. Quand il sera en exil au Mexique et aux États-Unis, et croisera sur son chemin Frida Kahlo, ce besoin de refléter la réalité en inventant des nouvelles formes ne le quittera jamais.
Et le film, dans sa forme et son récit, suit cette existence si changeante. Raison pour laquelle il avait été sélectionné au Festival de Cannes 2020 qui n’a pas eu lieu mais dont il a reçu le label officiel. Sur ce sauf-conduit, le long-métrage sort en salles en France le 30 septembre en attendant son arrivée en Espagne le 4 décembre. Auparavant il a été montré symboliquement à Perpignan début septembre avec l’accueil de toutes les autorités locales sauf la nouvelle mairie (d’extrême droite), signe de ce que raconte le film est toujours d’actualité. Et on a pu converser avec Aurel sur ce premier long-métrage, qui compte en plus avec la voix de Sergi López et la musique de Sílvia Pérez Cruz.

Aurel, Aurélien Froment (Ardèche, 1980), a déjà eu d’autres avant-premières en France de Josep, mais celle-ci à Perpignan est spéciale parce que la ville est l’épicentre de son film. Dans le cinéma Le Castillet on a même organisé une deuxième projection d’affilée parce que la première était complète. Des Français des Pyrénées Orientales, ces catalans du nord, étaient avides de découvrir les images de ce film dessiné, comme préfère l’appeler Aurel, où on raconte une passé partagée entre les générations qui étaient déjà là avant 1939 et beaucoup de descendants de ces républicains qui fuyaient les troupes franquistes. Et qui font remémorer ces camps d’internement qui ont fini en camps de concentration. Et d’où sortent les dessins de Josep Bartolí, qu’on intercale entre les séquences.
“C’est compliqué à dire ce qui me rapproche de Josep Bartolí au niveau du dessin parce que je ne peux pas en parler avec lui, mais je pense que c’est évidemment une vision politique des choses et aussi une approche du dessin”, nous répond Aurel à l’une de nos questions, à côté d’autres confrères de la presse locale. “J’ai fait le pari, qui m’a été un peu confirmé par Georges Bartolí son neveu, que Josep faisait partie de ces dessinateurs qui ont besoin de dessiner. C’est pas juste un outil, c’est aussi un besoin”.
Et Aurel enchaîne avec son cas : “moi je ne peux pas m’en passer, même en vacances. Je dessine tous les jours. Ce n’est pas mon travail, c’est un besoin. Et je suis persuadé que Josep Bartolí dans les camps, il a dessiné pas pour témoigner ni pour je ne sais pas quoi. Il a dessiné parce qu’il fallait qu’il dessine et c’était sa façon de survivre. C’est ça qui nous rapproche le plus”.
Dans la même salle pour l’interview il y a Serge Lalou, le producteur Les Films d’Ici Méditerranée de Montpellier, la boîte qui a fait possible le film en allant chercher d’autres partenaires pour sa fabrication et que l’année dernière était aussi derrière Josep Bartolí, le dessin pour mémoire, un documentaire de France 3 Occitanie qui commente ces dessins à partir la famille de Bartolí, historien·nes et dessinateurs ou scénaristes comme Paco Roca et Antonio Altarriba. Entre eux, il y a le neveu Georges Bartolí, photographe qui, il y a une dizaines d’années, faisait revivre le travail de son oncle dans La Retirada : exode et exil des républicains d’Espagne (Actes Sud, 2009/El Mono Libre, 2020), interviewé par Laurence Garcia (plus tard, en septembre 2021, nous l’avons interviewé en tant que commissaire de l’exposition Josep Bartolí. Les couleurs de l’exil au Mémorial de Rivesaltes).
Le désir de parler de Josep Bartolí

“En tant que dessinateur, j’étais complètement bluffé et happé par l’oeuvre graphique de Josep Bartolí”, se rappelle Aurel quand il a découvert le livre en même temps qu’il réalisait son court-métrage Octobre noir (2011), avec Florence Corre, sur les tragiques manifestations des algériens le 17 octobre 1961 à Paris. “Vu que j’étais en train de faire de l’animation, quelque chose de nouveau pour moi, j’ai tout de suite voulu essayer d’allier les deux en me disant que peut-être cette oeuvre-là était le projet qui me permettrai de faire un pas de plus dans le cinéma”.
Il s’est mis tout de suite en contact avec Georges, qui lui a raconté une vie si riche qu’elle n’est si simple à simplifier. “J’étais émerveillé à la fois par la qualité graphique et la puissance de ce qu’il racontait dans ses dessins. Et, puis, par cette vie romanesque qui avait traversé le siècle : des bas-fonds à Barcelone dans les années 1910 jusqu’à New York entre 1950 et 1995. Et Frida Kahlo au milieu de tout ça ! C’était énorme”.
C’est ici que surgit le scénariste Jean-Louis Milési, compagnon historique du cinéaste Robert Guédiguian. Avec Milési, les deux ont développé un récit fictionnel qui conserve les dessins de Bartolí et son issue en s’échappant des camps à partir du point de vue d’un gendarme imaginaire qui l’aide et qu’ils situent dans l’actualité pour le confronter aux nouvelles générations. “On avait Georges avec nous qui pouvait nous donner plein d’informations. Et aussi la veuve de Josep qui est toujours vivante (Bernice Bromberg). Mais il fallait faire du tri et trouver la bonne histoire à raconter au milieu de tout ça. Milési a permis de trouver l’angle fictionnel qui allait nous permettre de raconter l’essence de ce personnage, sans être obligés d’être exhaustifs”.

En fait, l’intrigue essaye de sortir d’une perception monolithique de toute la population française hostile aux républicains et en train d’être engloutie par la collaboration avec les nazis. “Les deux côtés étaient importants à montrer. On voulait dénoncer, entre guillemets même si ce n’est pas un film à charge ni à thèse, le mauvais accueil qu’avait était fait aux exilés en 1939. Mais on ne voulait pas non plus faire un film noir, procureur qui pointerait du doigt une faute gigantesque. Il faut qu’il y a de l’espoir. Et, de tout façon, c’était la réalité. Il y avait un accueil on ne peut plus dur et on ne peut plus répréhensible de la France vis-à-vis de ces gens. Mais il y avait aussi tout en chacun et des gendarmes qui étaient là pour aider et qui étaient beaucoup plus humains”.
Pour y arriver, pour les personnages et pour les décors, ils ont cherché entre le peu d’images photographiques qui existent de cette période. “Elle n’est pas tant documentée comme ça d’un point de vue d’archives, mais on s’est beaucoup servi de tout ce qu’on trouvait. Et il y a de belles images de gendarmes offrant le gîte ou donnant un biberon à un enfant”.
Personnages déracinés comme sujet

La méthode de travail de Aurel n’a pas été si différente que lorsqu’il travaille, pour la presse quotidienne ou en faisant des reportages graphiques, et cherche des lectures contemporaines. “J’ai toujours cette approche journalistique des choses. Et le film me permettait de couvrir un sujet historique avec des résonances dans l’actualité; peu connu pour le côté ‘Retirada’, totalement inconnu pour le côté Bartolí”.
Et, plus concrètement, autour de la question des réfugiés qui n’ont jamais été si nombreux dans le monde et qui mettent à nouveau l’Europe face à son histoire et sa responsabilité. Il y a une comparaison curieuse pour ce dessinateur de Montpellier : “j’ai toujours été très intéressé, passionné par la question du déracinement. En opposition avec mon histoire. Quand à l’adolescence j’ai appris que mes racines depuis des siècles et des siècles étaient originaires de quatre kilomètres de là où j’avais grandi, ça m’a fait un choc de me dire : j’ai absolument zéro exotisme autour de moi !”.
Par opposition, Aurel a toujours été intéressé par les gens qui se voient forcés de partir de son territoire. En 2014, il publie Clandestino. Un reportage d’Hubert Paris, envoyé spécial (Glénat), une fiction en bd tiré de plusieurs reportages en Algérie et en Espagne sur l’émigration des africains en Europe et toute la chaîne submergée ou officielle qui profite de ces individus sans droits. “Et, en même temps, j’étais aussi riche de cet enracinement. Ça m’a toujours questionné de savoir comment ça se passait pour des gens qui devaient s’éloigner, d’une manière forcée, de leurs racines. Qu’est-ce qui se passait avec cet exil. Ça m’attire de comprendre ce qui se passe et de prendre la défense de ces gens-là parce qu’ils le font rarement pour le plaisir”.
Révolution, guerre et camps de concentration

Connaître le passé pour comprendre le présent. C’est une génération entre Josep Bartolí et Aurel représentée par le neveu du premier Georges Bartolí qui s’est chargé de maintenir la flamme après son décès dans les années quatre-vingt-dix. Georges était aussi présent à l’avant-première à Perpignan. Et dans le dernier numéro de la revue Gibraltar, éditée à Toulouse, on dédie une trentaine des pages à Josep Bartolí avec un texte évocateur qu’à rédigé Georges et des photos qu’il a pris des endroits dans lesquels était passé son oncle pendant la guerre civile espagnole et son exode dans les camps d’internement, en plus des dessins de Josep. Il mentionne le livre Campos de concentración 1939-194…., que Josep Bartolí avec le journaliste Narcís Molins i Fàbrega avait réussi à publier au Mexique en 1944 et qui en Espagne n’est sorti qu’en 2007 (La Vieja Factoría).
“Cet ouvrage compile les dessins réalisés au cours de son périple de douleur dans les camps français”, écrit Georges. “Si Bartolí connaît la différence entre camp de concentration et camp d’extermination, il sait aussi que le deuxième suit toujours le premier. Ses croquis racontent crûment la réalité d’un système inique”. Son neveu suit le parcours de Josep dès ses aventures avec ses frères à Barcelone pour gagner son pain comme illustrateur à son entrée durant la Seconde République au Syndicat des dessinateurs professionnels jusqu’à la formation d’un comité révolutionnaire dans le sein de ce syndicat pour combattre les franquistes avec des affiches de propagande. Aussi son départ au Front d’Aragon dans la colonne communiste de Caridad Mercader (mère de Ramon Mercader, qui tuera Trotsky au Mexique), plus tard son travail de commissaire pour les mêmes trotskistes et, le 14 février 1939, son pas en France à travers le col de Lamanère (La Menera), à Prats de Molló, après avoir laissé derrière sa copine madrilène María Valdés qui fut sûrement tuée dans un raid de l’aviation de Mussolini contre le train qu’elle avait pris en direction Figueres.

“Pour combler l’ennui et l’indignation, Bartolí dessine avec frénésie”, raconte Georges sur ses trois ans d’allers-retours dans ces camps des Pyrénées Orientales et ailleurs. “La misère des siens, l’arrogance des geôliers à l’encontre des vaincus, la douleur encore de la mort, toujours. Camps d’internement de Saint-Cyprien, Rivesaltes, Le Bacarès dont il s’évade, l’hôpital militaire de Perpignan où le typhus manque de le terrasser, puis Bram, terrible camp disciplinaire dont les voies ferrées reçoivent des trains vides qui repartent chargés de prisonniers pour Dachau, vers l’Allemagne nazie”.
En fait, s’il sauve sa vie, c’est parce qu’il parvient à sauter d’un de ces trains en marche alors qu’un autre compagnon à lui se tue en se recevant mal. Pendant des mois, il erre en France jusqu’à qu’en 1942 il réussit à prendre un bateau à Marseille vers le nord de l’Afrique avec l’aide de Josep Tarradellas, futur président du gouvernement catalan après la mort de Franco. Depuis Casablanca, il embarque sur un autre bateau en direction de Veracruz, au Mexique. Et il récupère sa liberté pour toujours, avec souvent des voyages en France après la Seconde Guerre mondiale mais jamais en Espagne avant la mort de Franco.
De Frida Kahlo à l’abstraction de New York

Le film Josep prend ce périple de trois ans en France comme axe central, mais fait aussi des allers-retours entre l’époque actuelle et le passé à Perpignan et des épisodes de Bartolí au Mexique et à New York. Avec son histoire amoureuse avec l’artiste Frida Kahlo entre 1946 et 1949, qui s’est révélé en 2015 avec la vente aux enchères de la galerie new-yorkaise Dolye des lettres enflammées envoyés par Frida (Mara) à Josep (Sonja) en cachette de son mari Diego Rivera. Et pour lesquelles la galerie a obtenu 137.000 dollars. Josep gardait jalousement ces lettres, mais on n’a jamais trouvé celles qu’il envoyait à Frida.
L’itinéraire de ce personnage insaisissable continue avec son entrée dans les années cinquante comme illustrateur de la revue Holiday, avec laquelle il gagnera très bien sa vie et lui servira pour faire connaissance des stars à Hollywood. Mais son compromis artistique se maintiendra avec la relation à New York avec le Groupe 10th Street, les peintres de l’abstraction expressionniste, et une amitié spéciale avec Jackson Pollock et Franz Kline. Lui-même adoptera la couleur dans ses tableaux en poursuivant sa dénonciation sociale, qu’on peut observer dans ses livres Black man in America et Machismo.
Entre-temps, il était presque inconnu et ignoré en Espagne. À la mort de Franco, ses amis les écrivains Anna Murià et Agustí Bartra avec qui lui avait partagé une partie de son exil au Mexique essayent de le convaincre de rentrer en Catalogne. Un grand connaisseur de son oeuvre, Jaume Canyameres, réussit même à le faire recenser dans la ville de Terrassa, à vingt kilomètres de Barcelone, où habitaient déjà Murià et Bartra. Mais Bartolí n’y restera jamais, malgré qu’il y expose pour la première fois en Catalogne après la dictature en 1984. Après sa mort à New York en décembre 1995, l’avril suivant ses cendres seront dispersés dans les eaux du nord barcelonais de Premià de Mar, suivant sa volonté.
Le Mémorial de Rivesaltes dans le Perpignan d’aujourd’hui

Le travail de reconstruction du film de Aurel, dans les premières années le plus dures de l’exode, a été accompagné par le Mémorial du Camp de Rivesaltes, à dix kilomètres au nord de Perpignan. Inauguré en 2015 sur une partie de l’ancien camp militaire pendant le XX siècle, il avait vu défiler dans les pires conditions possibles les républicains espagnols, juifs, gitans, indésirables pour le régime de Vichy et, après, prisonniers allemands, tirailleurs guinéens, indochinois, algériens du FLNA, harkis, immigrés de tous types les derniers années…
Le jour de la présentation de Josep au cinéma Le Castillet il y avait la présidente socialiste du conseil général des Pyrénées Orientales et vice-présidente du Mémorial, Hermeline Malherbe, et aussi la vice-présidente écologiste de la région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, Agnès Langevine, qui ont cofinancé le film. Mais aucun représentant du la nouvelle mairie du Rassemblement National de Louis Aliot, qui s’est imposé aux élections municipales de juin. Une malaise parcourait la salle chaque fois qu’on évoquait indirectement le nouveau maire d’extrême droite.
“Ça nous rappelle combien dans le monde d’aujourd’hui c’est important de montrer ses images, cette histoire, ici à Perpignan je réinsiste lourdement”, manifestait Malherbe dans la présentation. “Vous avez vu qu’on n’a pas pu saluer l’ensemble de collectivités du territoire parce qu’il en a qui ne sont par là, et tant mieux !”, finissait la vice-présidente du Mémorial entre applaudissements du public. “Josep c’est finalement un frère, un oncle, un camarade… On a tous ici au Pays catalan une histoire, un lien, avec cet épisode tragique”, rappelait de sa part Langevine avant d’ajouter : “ces camps nous obligent à ce travail de mémoire, mais aussi à ce travail de lutte et de résistance”.
L’acte avait été introduit par le producteur Serge Lalou, qui en 2016 avait gagné l’Ours d’or à la Berlinale pour Fuocoammare, de Gianfranco Rosi, documentaire sur la crise migratoire dans l’île sicilienne de Lampedusa.
Travail en équipe et la musique de Sílvia Pérez Cruz
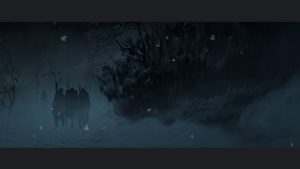
Aurel même reconnaît qu’il ne savait presque rien de la Retirada jusque que, il y a une décennie, la région avait commémoré les 70 ans avec un CD des témoignages des gens qui étaient encore vivants. Pour son long-métrage, il a aussi compté avec la coproduction de la boîte audiovisuelle barcelonaise Imagic TV de Jordi B. Oliva. Une équipe totale d’environ soixante personnes pendant cinq ans, qu’il devait coordonner quand d’habitude il est tout seul devant la table en dessinant ses images pour la presse. “Mais j’avais, à priori, la décision finale sur tous les choix artistiques”, se félicite l’auteur.
Tous ces contacts lui ont permis d’avoir quelques voix célèbres pour les personnages. Gérard Hernández, Bruno Solo ou Valérie Lemercier, du côté français, et Sergi López ou Sílvia Pérez Cruz, du côté catalan. L’élection de Sergi López s’est fini pour imposer dans la voix de Josep Bartolí, en catalan, espagnol et français. Dans le cas de Sílvia Pérez Cruz, en catalan mais aussi dans le rôle de Frida Kahlo, la rencontre est allée au-delà. “J’ai connaissais sa musique, et je savais qu’elle est très connue en Espagne, encore plus en Catalogne, et totalement méconnue en France. J’avais très envie que ce soit elle. J’ai fait son portrait pour le journal ‘Le Monde’ en reportage graphique. Je lui ai parlé du film, et ça l’a intéressée”.
Sur la lancée, on lui a proposé aussi de faire la bande son. “Et c’est un choix que je ne regrette absolument pas. Un des principaux retours que j’ai eu, c’est la forme du film qui est assez originale et qui doit beaucoup à la bande son. Elle ne se contente pas des chansons comme on en connaît de Sílvia Pérez Cruz. C’est un travail d’orfèvre, à la fois de création et de liaison entre le son et l’image qui est réellement de la dentelle”.
Une combinaison que Aurel apprécie beaucoup parce qu’il a aussi fait des couvertures pour Jazz Magazine et des bd sur des figures du genre pour le coffrets du label Nocturne, en plus de travailler pour des artistes comme Massilia Sound System ou Natacha Atlas. “Le cinéma me permet de répondre à quelque chose qui m’a toujours obsédé, que c’est du mettre du son sur mes dessins. En fait quand j’étais en studio avec les gens qui faisaient le son, que se soit la musique de Sílvia, les mixeurs, les bruiteurs, je me sentais presque autant dans mon élément que quand j’étais en train de parler avec des gens qui faisaient de l’image”.
Le prix de figurer dans la Sélection Officielle cannoise

Cerise sur le gâteau, le film a été sélectionné à Cannes même si le festival de cinéma n’a pas eu lieu à cause de la pandémie. “Quand on a su qu’on était sélectionné à Cannes, je me suis demandé quelle est la proportion des chances dans ta vie de réaliser un film. Quelle est la proportion des chances dans ta vie d’arriver à qu’il voit le jour. Quelle est la proportion des chances que ce film-là soit sélectionné à Cannes. Et quelle est la proportion des chances que, l’année qui tu es sélectionné à Cannes, ce soit l’année où n’a pas lieu parce qu’il a un virus mondial… Je le prends comme ça, à la rigolade, parce qu’il n’y a pas d’autre manière de le prendre”. Qu’importe, le film arrive dans les salles avec le label Sélection Officielle Cannes 2020 et ainsi sera présenté fin octobre en Espagne au festival de Valladolid, la Seminci
C’est une opportunité pour rappeler les paroles qui avait écrit Anna Murià dans le prologue du livre d’entretiens de Jaume Canyameres Conversation avec Bartolí (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990) : “Qui contemple l’oeuvre de Bartolí, reçoit beaucoup de suggestions, fait beaucoup de suppositions. Moi, toutes elles me conduisent à voir en lui le prototype d’homme du Vingtième Siècle. Peut-être parce que je suis une femme du Vingtième Siècle. Je sais ce que signifie d’être du Vingtième Siècle. Ça signifie d’être fait de tout ce que j’ai insinué dans les pages précédentes, ça veut dire de porter dans l’esprit et les nerfs, dans l’histoire personnelle, tout ce qui compte d’amour et d’haine, de bien et de mal, l’œuvre de Bartolí”.
Guerra
Todas las madres del mundo,
ocultan el vientre, tiemblan,
y quisieran retirarse,
a virginidades ciegas,
el origen solitario
y el pasado sin herencia.
Pálida, sobrecogida
la fecundidad se queda.
El mar tiene sed y tiene
sed de ser agua la tierra.
Alarga la llama el odio
y el amor cierra las puertas.
Voces como lanzas vibran,
voces como bayonetas.
Bocas como puños vienen,
puños como cascos llegan.
Pechos como muros roncos,
piernas como patas recias.
El corazón se revuelve,
se atorbellina, revienta.
Arroja contra los ojos
súbitas espumas negras.
La sangre enarbola el cuerpo,
precipita la cabeza
y busca un hueco, una herida
por donde lanzarse afuera.
La sangre recorre el mundo
enjaulada, insatisfecha.
Las flores se desvanecen
devoradas por la hierba.
Ansias de matar invaden
el fondo de la azucena.
Acoplarse con metales
todos los cuerpos anhelan:
desposarse, poseerse
de una terrible manera.
Desaparecer: el ansia
general, creciente, reina.
Un fantasma de estandartes,
una bandera quimérica,
un mito de patrias: una
grave ficción de fronteras.
Músicas exasperadas,
duras como botas, huellan
la faz de las esperanzas
y de las entrañas tiernas.
Crepita el alma, la ira.
El llanto relampaguea.
¿Para qué quiero la luz
si tropiezo con tinieblas?
Pasiones como clarines,
coplas, trompas que aconsejan
devorarse ser a ser,
destruirse, piedra a piedra.
Relinchos. Retumbos. Truenos.
Salivazos. Besos. Ruedas.
Espuelas. Espadas locas
abren una herida inmensa.
Después, el silencio, mudo
de algodón, blanco de vendas,
cárdeno de cirugía,
mutilado de tristeza.
El silencio. Y el laurel
en un rincón de osamentas.
Y un tambor enamorado,
como un vientre tenso, suena
detrás del innumerable
muerto que jamás se aleja.
Miguel Hernández
Cancionero y romancero de ausencias (1938–1941)
Poème d’où Sílvia Pérez Cruz a tiré la chanson Todas las madres del mundo (Toutes les mères du monde) pour le générique du film
Views: 3472
